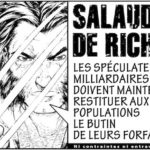La première fois que j’ai vu et entendu Aurélien, je l’ai trouvé franchement…
Comment peut-on vivre et penser
dans une Assemblée composée
pour une grande part de vrais
psychotiques, d’authentiques
élus assurément cinglés
Comment conserver son calme
sans perdre raison et santé
au milieu d’un tel vacarme
et préserver sa dignité
sur des bancs à la dérive
soumis aux cris insolences
injures et invectives
pensai-je devant mon café
Comment résister à l’envie
de regarder le monde passer
et penser et vivre à vide
songeai-je enfin tôt ce matin
quand un jeune con d’Insoumis
du joli nom d’Aurélien
qui sait le poids le sens des mots
de sa superbe en plein chaos
vous tire aux côtés de Pajot
Simmonet Bompard et Ruffin
une rafale dans le dos
Ainsi fut-il dit d’Olivier
Dussopt qu’assassin il était.
.