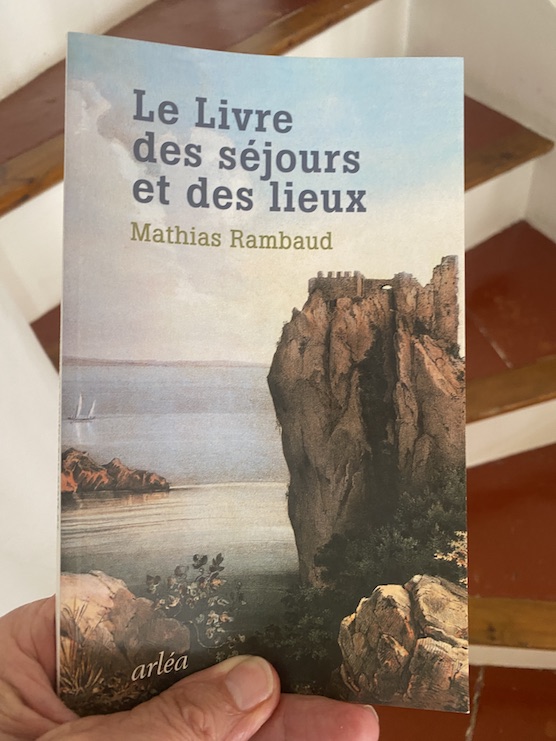Laissez-moi.

Ma.27.3.2024
Dimanche au cinéma (Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand Narbonne)
« Laissez-moi » de Maxime Rappaz, avec Jeanne Balibar, Thomas Sarbacher, Pierre-Antoine Dubay.
Un train au cœur de la montagne. Une femme à la fenêtre. Pensive, rêveuse. Nous traversons avec elle, lentement, des paysages grandioses. Qu’elle ne voie pas. Ainsi, Claudine, la cinquantaine élégante, se rend tous les mardis dans un hôtel, non loin d’un gigantesque barrage. Elle n’a pas de bagages. Là, elle questionne le réceptionniste pour savoir quels sont les hommes de passage. Dans le salon, elle s’asseoie seule à une table, attend, observe et s’approche de sa proie. Elle minaude, rit un peu, lui demande de raconter sa ville. Et très vite lui propose de monter dans sa chambre. Son désir d’étreintes et de caresses satisfait auprès de quelqu’un qu’elle ne reverra pas, Claudine, redescend dans la vallée. Avant de rejoindre sa maison à l’écart du village, elle poste une lettre à l’adresse de son grand fils handicapé qui vit seul avec elle. Une lettre qui lui raconte les villes de ses amants (de son père). Mère dévouée, un amour réciproque les unit qui les enferme tous les deux. Ainsi, va la vie de Claudine entre deux âges, deux rôles, deux mondes… Jusqu’à l’arrivée de Michael, un homme de passage dans le cadre d’une mission professionnelle, qui va bouleverser l’ordre et les certitudes de Claudine. Avec ce premier film, Maxime Rappaz fait une magnifique déclaration d’amour à Jeanne Balibar. Sa caméra, subtile et pudique, caresse chacun de ses gestes, goûte son phrasé, enveloppe son corps, dans l’extase, ses travaux de couture ou les soins apportés à son fils. Un beau film, comme je les aime, tout en retenue et profondeur, sublimé par le talent vertigineux d’une Jeanne Balibar bouleversante de vérité – et de beauté…