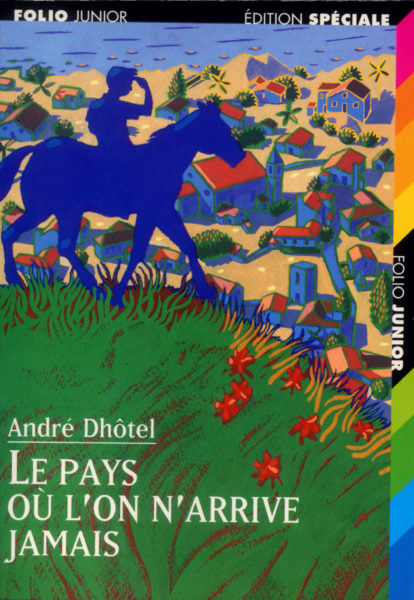Un dimanche au cinéma : « l’innocent » de Louis Garrel.
Il faisait un temps gris, l’air était chaud, lourd et poisseux. Une atmosphère pesante ! J’aurais aimé qu’éclatât un bel orage. Les sols ont besoin d’eau. Et nos esprits d’être distraits. Le climat politique est en effet chargé : guerre à nos portes, pénurie de gaz et d’électricité cet hiver, répression et violences envers les femmes en Iran, extrêmes droites un peu partout… À l’affiche du Théâtre-Cinéma du Grand Narbonne était « L’innocent » de Louis Garrel. Un film léger et intelligent selon le programme. J’ai donc décidé d’aller le voir. Quitter une heure trente durant ce monde cynique et brutal.
L’histoire tourne autour de Sylvie (Anouk Grinberg). Elle anime des ateliers théâtraux dans les prisons. C’est une petite personne joviale, piquante et passionnée. Elle vient de trouver, après trois échecs amoureux dans ce même milieu, « l’homme de sa vie », Michel (Roschdy Zem). Bientôt libéré, veste de cuir sur un physique avantageux, il a le charme du « bon truand » à l’ancienne. Folle de joie, elle l’épouse en prison et se lance à sa sortie, avec lui, dans le commerce de fleurs. Il va de soi pour Sylvie que Michel est tout aussi amoureux qu’elle, qu’il s’est définitivement retiré des « affaires ». Ce que ne croit pas son fils, Abel (Louis Garrel), jeune veuf inconsolable qui s’inquiète beaucoup pour sa mère et se met à surveiller de très près, en cachette, ledit Michel. Sa meilleure amie, Clémence (Noémie Merlant), jolie fille sympathique et délurée, entre dans son jeu. Elle est, en vérité, animée par l’amour, brûlant et caché, qu’elle éprouve pour Abel.
Dans ce film, Louis Garrel mélange avec brio les genres du polar, de la comédie et du « mélo ». Sa musique et sa bande-son sont celles des chansons de variétés que chante Sylvie (« Pour le plaisir », d’Herbert Léonard, « Une autre histoire », de Gérard Blanc, « Nuit magique », de Catherine Lara…). Des airs et des paroles qui chantent l’espoir, l’amour, la peine, la douleur. Sylvie est une Emma Bovary intermittente du spectacle des années 80 !
L’histoire se noue et prend du rythme quand Abel et Clémence se retrouvent embringués jusqu’au cou dans le braquage organisé par Michel. Ensuite, le quatuor d’acteurs excelle.
Je n’avais rien lu concernant ce film jusqu’à cet après midi de dimanche. « L’innocent » n’est certes pas un chef-d’œuvre, comme semble le proclamer une critique solidairement enthousiaste. Mais je l’ai trouvé touchant, intelligent. Sans prétention. Le scénario est simple, classique, vif, bien ordonné et les acteurs jouent parfaitement leur partition.
Bref ! J’ai passé un bon moment, loin du bruit médiatique ambiant, constant, perturbant et anxiogène. C’est déjà beaucoup plus que je ne l’espérais. À voir !