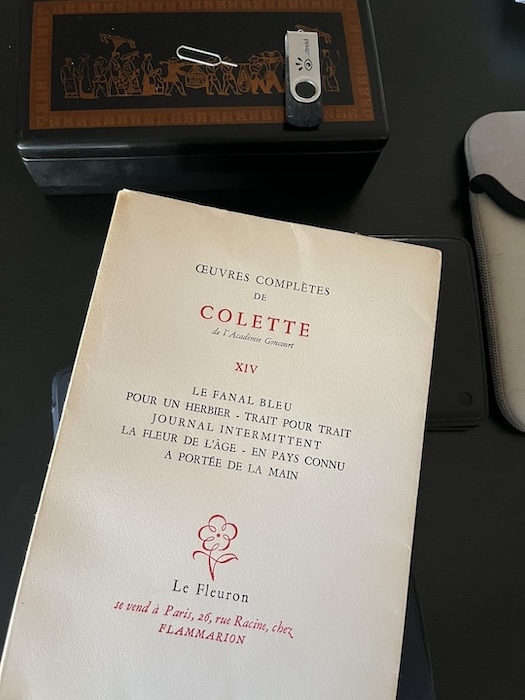Un moment de vie d’une grande vulgarité…

Sa.30.8.2024
Je suis assis en première ligne à l’une de mes habituelles terrasses de café. Celle des samedis et des dimanches matin d’été. La seule à l’ombre. Sur ma table, un crème, un biscuit et une baguette de pain achetée chez Anatole. Aux Halles. Idéalement placé, j’observe avec curiosité les nombreux passants qui s’y rendent. En touristes ou pour y faire leurs courses. Un couple aux dimensions éléphantesques s’en détache. Ils s’installent bruyamment derrière moi. Leurs vêtements sont informes et douteux. Ils transpirent abondamment. Je sens leur odeur âcre et piquante. Lui agite l’air de ses bras, elle scrolle frénétiquement. Ils gesticulent, crient, réclament le serveur long, fin et droit occupé à la table voisine. Qui, imperturbable, finit sa commande et pénètre dans cette énorme bulle de vulgarité. Sans obtenir de réponse à son bonjour digne et professionnel. Une leçon de sang-froid. Un modèle de patience. Indigné, je me lève et le suis jusqu’au comptoir. Je veux qu’il sache que je suis blessé par tant de brutalité, d’insolence. Les yeux bas, un léger sourire en coin, il me dit, résigné : « c’est ainsi tous les jours, toutes les heures… »