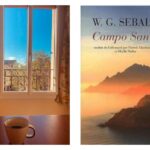Carte postale : Un samedi matin au marché aux livres de Montpellier, le passé vint à ma rencontre…
Samedi, rendez-vous à Montpellier avec Jean-Claude et Francine, « des amis de plus de quarante ans » , – de mes premières années professionnelles en région parisienne, précisément, et retrouvés depuis leur installation à Nîmes –, pour y déjeuner dans un restaurant où j’ai mes habitudes – récentes, cependant. Mais avant de les rejoindre, comme à chaque occasion qui m’amène, en fin de semaine, dans cette ville où j’ai vécu pendant près de 15 ans, je consacre un peu de mon temps à passer d’une table à l’autre de son Marché aux livres installé sur l’esplanade du Corum. D’autant que les premières feuilles d’un alignement de platanes, sous lesquels les derniers bouquinistes finissaient d’installer leurs présentoirs, se prêtaient, plus que d’autres jours plus sombres de l’hiver dernier, par la grâce d’un ciel parfaitement bleu, à la lecture attentive de quelques pages d’un livre repéré sur l’un d’entre eux. C’est ainsi que, dans un état de rêverie attentive, je lisais et relisais le final d’une nouvelle – Les Morts – de Joyce ; un final que Steiner raconte, dans l’ouvrage – Errata – que je tenais entre mes mains, avoir lu à haute voix puis commenté dans sa chambre à des camarades d’étude troublés par ses beautés rhétoriques, au point d’en silencieusement pleurer.
Quelques légers coups frappés contre la vitre le firent se tourner vers la fenêtre. Il s’était mis à neiger. Il regarda dans un demi-sommeil les flocons argentés ou sombres tomber obliquement contre les réverbères. L’heure était venue de se mettre en voyage pour l’Occident. Oui, les journaux avaient raison, la neige était générale en toute l’Irlande. Elle tombait sur la plaine centrale et sombre, sur les collines sans arbres, tombait mollement sur la tourbière d’Allen et plus loin, à l’occident, mollement tombait sur les vagues rebelles et sombres du Shannon. Elle tombait aussi dans tous les coins du cimetière isolé, sur la colline où Michel Furey gisait enseveli. Elle s’était amassée sur les croix tordues et les pierres tombales, sur les fers de lance de la petite grille, sur les broussailles dépouillées. Son âme s’évanouissait peu à peu comme il entendait la neige s’épandre faiblement sur tout l’univers comme à la venue de la dernière heure sur tous les vivants et les morts.
Je lisais et relisais donc ce texte, quand un amical « bonjour Michel Santo ! », inattendu en ce lieu, m’en fit sortir pour lever mes yeux sur le visage toujours aussi familier d’un de mes anciens collaborateurs perdu de vue depuis plus de 20 ans. Jacques Dartigue, puisqu’il s’agit de lui, se tenait là, devant moi, tout sourire, lui-même étonné de cette improbable et pourtant prévisible circonstance. Épris de littérature, sa trajectoire, en effet, devait fatalement un jour croiser la mienne et nous permettre ainsi de renouer le fil de nos discussions sur des bonheurs de lecture et des auteurs aimés, dont je prétendais alors, ce que je persiste encore à penser, qu’ils enrichissent un usage du temps strictement professionnel, convaincu, depuis la lumineuse découverte du Lucien Lewen de Stendhal, que cette littérature apportait plus de connaissances sur la nature humaine et les rapports sociaux en général que tous les livres de sociologie, notamment, longtemps considérés par « ma génération » d’intellectuels comme absolument indispensables à « tout honnête homme ». Jacques étant toutefois d’un tempérament rêveur et tourmenté, je l’avais, pour éviter qu’il ne se laisse envahir par sa passion littéraire, affecté à des travaux, disons plus méthodiques, qui l’ennuyaient sans doute profondément, mais qui lui permettaient de satisfaire ses besoins domestiques (il faut bien vivre !) ; travaux ingrats, certes, mais qu’il compensait par une participation éditoriale aux Cahier des Brisants, une petite maison d’édition de Mont de Marsan,qui publiait, à cette époque, des auteurs rares, dont Charles Juliet, ami de Jacques, qui, jadis, à l’occasion d’une de nos conversations entre deux portes ou dans mon bureau, me fit l’éloge des tout premiers livres de son journal – ceux d’un écrivain terriblement angoissé par les conditions précaires de sa vie et sa recherche d’une langue poétique propre à son être singulier – et devenu depuis une personnalité reconnue de la scène littéraire française…
Le temps passait malheureusement trop vite et nous nous sommes à nouveau quittés pour rejoindre nos amis, chacun de notre côté, tout en nous promettant cependant de reprendre ce bref échange de souvenirs un jour prochain ; un samedi, à Montpellier, évidemment !
Plus tard, je dirai à Jean-Claude et Francine, comment, par le hasard d’un livre de George Steiner feuilleté devant la table d’un bouquiniste, une part de mon passé s’est vivement présentée à mon visage…
Mots-clefs : Cahier des Brisants, Charles Juliet, Errata, Jacques Dartigue, Joyce, Marché aux livres, Montpellier, Steiner
Rétrolien depuis votre site.