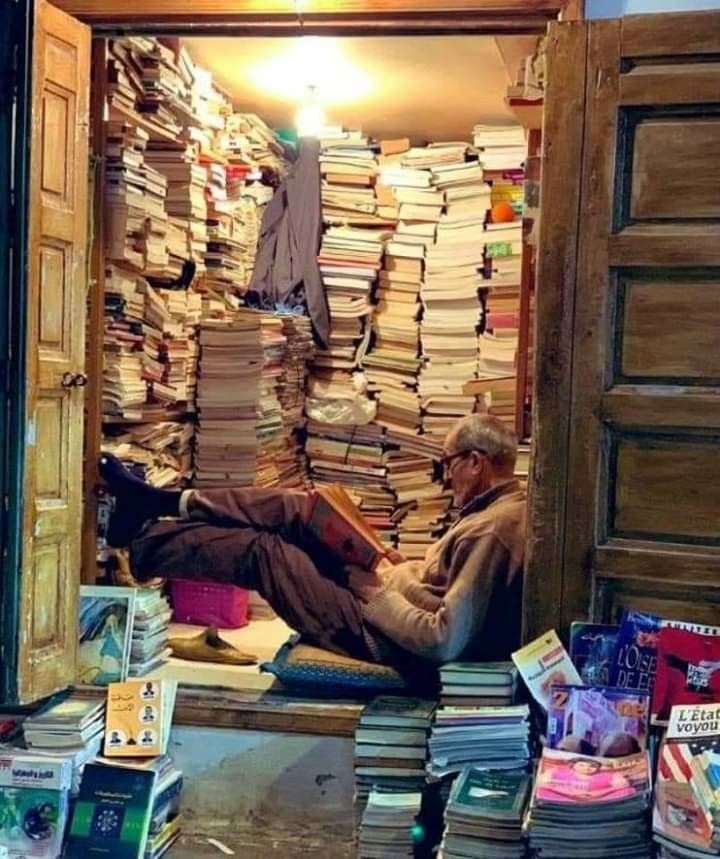Éclats de mémoire – d’une vie…





Lu.15.1.2024
Ehpad de Lézignan. Il est 16 h 45.
Je lui tournais le dos quand elle est entrée dans cette chambre dite de transition. La porte était ouverte. Elle s’est approchée pour me dire quelques mots avant de quitter son service. On m’a rapporté que votre mère avait souri en vous voyant. Je l’ai cru, mentis-je. En vérité, ses yeux sont mi-clos, sans lumière, ils se ferment quand je pose ma main sur son front. Oui, répond-elle à mes questions, on lui injecte des anxiolytiques par voie capillaire et de la morphine. Elle ne souffre pas. La voix de cette infirmière révèle un léger accent slave tout en douceur. Comme dans le bleu satiné et fondu de ses yeux sur le velours d’un fond de teint naturellement pâle. Elle est lituanienne. Je lui dis que j’aimerais que ma mère parte dans l’instant. Que je ne cesse de penser à son corps rétréci, minuscule, qui s’éteint lentement ; ce corps qui fut le mien aussi avant de me donner la vie.
PS : Mardi. Il est 19 heures. La direction de l’Ehpad m’informe de son décès. Sa fin de vie aura été malgré tout digne et douce…





Sa.6.1.2024