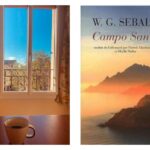Edward Hopper et l’éloge du rien.

Les toiles d’Hopper m’ont toujours fasciné. Et les commentaires érudits sur son œuvre toujours déçus. Exclusion, mélancolie, aliénation reviennent sans cesse. Surtout sous la plume de critiques français, qui ne voient , chez Hopper, que le peintre d’une société américaine par essence plate, froide et opprimante. Comme si le silence, la tension, l’exclusion, voire la mélancolie qui enveloppent ses personnages étaient le propre d’un pays, d’une époque. Comme si George de la Tour, Goya, Munch… , en d’autres temps et d’autres espaces, n’avaient pas, eux aussi, tentés de cerner ce qui réside au plus profond de nos consciences : la solitude et l’attente. Ainsi de cette toile où le lieu de la scène, un bar vivement éclairé et sans murs, semble plonger, tel l’étrave d’un paquebot, dans l’océan de la nuit. Trois personnages y bavardent. Indifférents au quatrième, de dos, dont l’ombre ne laisse à la lumière que le bas d’un visage penché sur un verre que l’on devine à peine. Le mouvement de ses épaules marque la fatigue de l’attente. Le monde entier semble reposer sur lui. Mais que regarde-t-il ? Ce jour qui s’éteint, emporté ? La pensée et le monde, vides en cette heure ? La solitude est en nous comme une lame, nous dit Christian Bobin, dans son « éloge du rien », profondément enfoncée dans les chairs. On ne peut nous l’enlever sans nous tuer aussitôt. L’amour ne la révoque pas, il la parfait. Et qui nous dit de cet homme, qu’en cet instant où plus rien n’est à attendre sinon l’inattendue, dans sa nuit, au loin, qu’il n’est pas au plus près de la saisir. Comme une prière le vent, comme une âme son être. Le génie d’Edward Hopper est dans cette faculté qu’il a de transformer la banalité des formes et des situations en représentations d’un univers métaphysique d’une profondeur inouïe. Le glacé de ses toiles en lumineuses rêveries. Le rien de la vie en tout de l’être… Inutile de dire qu’on l’aime…