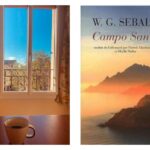Lecture d’Anatole France.
J’ai déniché, la semaine dernière, chez mon bouquiniste, l’édition du 28.12.1948, chez Calmann-Lévy, en parfait état, d’ « Histoire contemporaine », d’Anatole France. Depuis, passant outre le jugement commun et celui d’Aragon sur l’auteur de cette tétralogie satirique de la société française sous la Troisième république : « Exécrable histrion de l’esprit. Je tiens tout admirateur d’Anatole France pour un être dégradé. », je suis, avec délectation, les heurs et malheurs conjugaux et professionnels de M. Bergeret, professeur de lettres anciennes, esprit sceptique et doux. Hier au soir, par exemple, je me suis endormi, le sourire aux lèvres sur les pages 299-303. Extraits :
… « Le journal, en effet, portait en manchette l’annonce d’un de ces incidents communs dans notre vie parlementaire, depuis le mémorable triomphe des institutions démocratiques. Les Saisons alternées et les Heures enlacées avaient ramené en ce printemps, avec une exactitude astronomique, la période des scandales. Plusieurs députés avaient été poursuivis dans ce mois. Et la feuille déployée par M. Bergeret portait en lettres grasses cette mention : « Un sénateur à Mazas. Arrestation de M. Laprat-Teulet. » Bien que le fait en lui-même n’eût rien d’étrange et révélât seulement le jeu régulier des institutions, M. Bergeret jugea qu’il y aurait peut-être quelque affectation d’insolence à l’afficher ainsi sur un banc du Mail, à l’ombre de ces ormes sous lesquels l’honorable M. Laprat-Teulet avait joui tant de fois des honneurs que les démocraties savent accorder aux meilleurs citoyens. C’est là, sur ce Mail, que dans une tribune de velours grenat, sous des trophées de drapeaux, M. Laprat-Teulet, siégeant à la droite de M. le président de la République, avait, aux grandes fêtes régionales ou nationales, aux inaugurations diverses et solennelles, prononcé ces paroles si propres à exalter les bienfaits du régime, en recommandant toutefois la patience aux masses laborieuses et dévouées. Laprat-Teulet, républicain de la première heure, était depuis vingt-cinq ans le chef puissant et vénéré de l’opportunisme dans le département. Blanchi par l’âge et les travaux parlementaires, il se dressait dans sa ville natale comme un chêne orné de bandelettes tricolores. Il avait enrichi ses amis et ruiné ses ennemis. Il était publiquement honoré.Il était auguste et doux. Il parlait aux petits enfants de sa pauvreté, chaque année, dans les distributions de prix. Et il pouvait se dire pauvre sans se faire de tort, car personne ne le croyait, et l’on ne pouvait douter qu’il ne fût très riche ….Sage, jaloux de ne pas fatiguer la fortune, modéré, ce grand aïeul de la démocratie laborieuse et intelligente avait depuis dix ans, au premier souffle de l’orage, renoncé aux grandes affaires ; il avait quitté même le Palais-Bourbon et s’était retiré au Luxembourg, dans ce grand conseil des communes de France où l’on appréciait sa sagesse et son dévouement à la République. Il y était puissant et caché. Il ne parlait qu’au sein des commissions. … Ni l’honorable M. Laprat-Teulet, ni son juge d’instruction, ni son avocat, ni M. le procureur de la République, ni M. le garde des sceaux lui-même n’avait prévu, n’avait compris la cause de ces déclenchements subits et partiels de la machine gouvernementale, ces catastrophes burlesques comme un écroulement d’estrade foraine et terribles comme un effet de ce que l’orateur appelait la justice immanente, qui par moments culbutaient de leur siège les plus vénérés législateurs des deux Chambres. Et M. Laprat-Teulet en concevait un étonnement mélancolique…. »
C’est fin, élégant, subtil et ironique. Le style est l’homme même, en effet, et le sien suffit à définir la petitesse de nos histrions contemporains gangrénés par l’exécrable esprit journalistique…